Attachés aux valeurs de la république liberté, égalité, fraternité, porteurs de ses idéaux universalistes, et nourris à l’humanisme des philosophes des lumières, les Franc Maçons voient dans l’école le meilleur outil pour fabriquer une société libre composée de femmes et d’hommes libres et éclairés.
Au travers de l’exposé du jour, nous allons essayer d’ancrer le triptyque qui la résume (gratuite, obligatoire, laïque) dans sa perspective historique, dans les grands débats qui la traversent, et dans les oppositions qui l’ont façonné et, disons-le dès à présent, la menacent.
L’ancien régime
L’enseignement élémentaire, celui où on apprend à lire, écrire et compter, a longtemps relevé de l’initiative privée. Les familles les plus fortunées engageaient un précepteur qui instruisait voire même éduquait leurs enfants. Dans quelques villages, des prêtres catholiques, eux aussi, sous-formés, jusqu’au milieu du XVIe siècle, faisaient quelques heures de cours en hiver pour les enfants des paysans. Cependant Louis XIV en lutte pour éliminer le protestantisme de son royaume, s’intéresse à l’enseignement élémentaire. En 1698, il ordonne à chaque communauté villageoise d’ouvrir une école dont le maître sera un prêtre catholique ou une personne choisie par le prêtre. Un peu partout des écoles de villages ou de quartiers s’ouvrent. Cependant, le taux d’alphabétisation reste faible.
L’enseignement secondaire avait pour but principal de commencer la formation intellectuelle des « cadres » civils, militaires et religieux nécessaires au fonctionnement du pays. Il a vite retenu l’attention des autorités royales et de l’Église catholique. Pendant longtemps il n’a concerné que les garçons des classes dirigeantes (petite noblesse et bourgeoisie).
Avant la révolution de 1789, l’enseignement secondaire était donné dans des collèges tenus par les jésuites jusqu’à leur expulsion en 1764 et les oratoriens dispensant leur formation à la jeunesse aisée (uniquement les garçons). Les filles, elles vont au couvent en attendant le mariage. Dans ces établissements, elles doivent recevoir une bonne éducation car c’est la mère qui doit enseigner la religion aux enfants, cette éducation est la première raison de l’apprentissage de la lecture à la femme.
Sous l’Ancien Régime, l’institution scolaire est sous la tutelle de l’Église, et la religion est la finalité de l’enseignement. Le Traité des études de Rollin, en 1726, proclame que « la fin de toutes nos instructions doit être la religion ». Cette conception, ainsi que le monopole accordé à la religion catholique, sont en conformité avec le régime de monarchie de droit divin.
C’est ce que contestent des réformateurs inspirés par les Lumières, au premier titre desquels Condorcet, qui présente les 20 et 21 avril 1792, à l’Assemblée un rapport et un projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique.
- école primaire 6 à 10 ans (lire, écrire, compter)
- école secondaire 10 à 13 ans (histoire, géo, arts mécaniques, dessin, maths, physique, histoire naturelle et sciences sociales)
- instituts (lycée)
- lycée (Université)
Cet enseignement serait obligatoire pour les filles et les garçons, gratuit (bourses), protégé de tout dogmatisme, ouverte à la raison critique et assujettie à aucune autorité religieuse. Chaque citoyen, tout au long de sa vie, aurait la possibilité d’apprendre et d’accroître ses connaissances. Cette instruction serait dispensée par des hommes de savoir, qui agiraient comme des gardiens des Lumières et qui, indépendants du pouvoir, seraient les garants des libertés publiques.
L’école que veut créer Condorcet conduit inévitablement à la République car son projet tend à former des citoyens libres, égaux et fraternels.
Le projet fut jugé contraire aux vertus républicaines et à l’égalité, livrant l’éducation de la Nation à une aristocratie de savants.
Le décret du 17 mars 1808 qui fonde l’Université impériale édicte que toutes les écoles « prendront pour base de leur enseignement : 1) les préceptes de la religion catholique ; 2) la fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale […] et à la dynastie napoléonienne ». Ce n’est pas un simple retour à l’Ancien Régime. En effet, l’Université impériale a reçu le monopole de l’enseignement, ce qui consacre la disparition du magistère de l’Église. L’Église catholique demeure une institution structurante, conformément à la logique du Concordat (1802), mais son rôle n’est plus coextensif à la société globale. Dans ce cadre, la morale reste assise sur la religion ; mais dans la logique des « cultes reconnus », protestantisme et religion juive peuvent servir de base à la morale aussi bien que le catholicisme. C’est dans ce sens qu’agit Guizot, à partir de 1833 : dans la mesure du possible, chacun des trois cultes reconnus doit avoir ses propres écoles primaires.
Cette situation est néanmoins inacceptable pour les nostalgiques de l’Ancien Régime, pour qui l’Église catholique devrait retrouver son rôle directeur en matière d’enseignement. La Restauration renonce à supprimer l’Université, mais entraîne une cléricalisation de celle-ci. Le ministère de l’Instruction publique, créé en 1824, est ainsi initialement relié aux Affaires ecclésiastiques. C’est l’ordonnance du 4 janvier 1828, prise après la victoire électorale des libéraux, qui détache l’Instruction publique des Affaires ecclésiastiques. Conséquence : une partie de la droite cléricale va désormais réclamer la liberté de l’enseignement, c’est-à-dire le droit de fonder des établissements en dehors de l’Université.
En 1833, François Guizot accorde la liberté de l’enseignement primaire. Rivalisent désormais écoles primaires publiques et écoles primaires privées, le plus souvent congréganistes. Au demeurant, des congréganistes peuvent également enseigner dans des écoles publiques. Sous la monarchie de Juillet, les cléricaux se battent aussi pour obtenir la liberté de l’enseignement secondaire. À leurs yeux, les collèges sont des écoles d’incrédulité, car quelle que soit la considération accordée à l’aumônier, la religion y est séparée des disciplines profanes et la coexistence d’élèves de plusieurs confessions jette le discrédit sur chacune d’elles.
En 1848, les « journées de juin » ont tant effrayé la bourgeoisie que même un « voltairien » comme Thiers se rallie à l’idée de renforcer le rôle éducatif de l’Église, en particulier dans l’enseignement primaire : est ainsi affermie la tutelle des curés sur les instituteurs publics, suspects de socialisme. Les cléricaux jouent alors sur les deux tableaux : ils cherchent à contrôler l’enseignement public, (les évêques figurent en bonne place au sein du Conseil supérieur de l’Instruction publique) ; en même temps, ils développent activement les établissements « libres ».
Les débats sur la loi Falloux
Le débat sur la « liberté d’enseignement » prend un tour particulièrement vif à l’occasion de l’étude de la loi Falloux, du nom du comte Alfred de Falloux, ministre de l’Instruction publique et appartenant au Parti de l’Ordre.
Le 18 juin 1849, celui-ci dépose un projet de loi portant son nom ayant pour but d’étendre la loi Guizot de 1833 sur l’instruction. L’esprit du projet est résumé dans cette phrase de Falloux, extraite de ses Mémoires : « Dieu dans l’éducation, le pape à la tête de l’Église, l’Église à la tête des civilisations. » La loi prévoit ainsi de supprimer le monopole de l’État dans l’enseignement établi par Napoléon Ier en redonnant une grande place à l’enseignement confessionnel dans le primaire et dans le secondaire. Un an après la révolution de 1848, il s’agit, pour les conservateurs alliés aux catholiques, de reprendre en main l’éducation des jeunes Français et de les « délivrer » de l’emprise des instituteurs républicains, supposés responsables de l’agitation révolutionnaire.
Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. Aux yeux des républicains, l’échec de la Deuxième République tient à l’insuffisante instruction du peuple, encore soumis à l’opinion des notables et du clergé réactionnaire. Seule l’instruction pourra apporter les lumières nécessaires au vote républicain. L’avènement de la République est ainsi lié au progrès de l’instruction, pourvu que celle-ci puisse avoir des vertus émancipatrices, ce qui suppose qu’elle soit laïque.
Lors de la discussion à la Chambre, qui débute le 14 janvier 1850, un député va prendre la tête de l’opposition au projet Falloux. Il s’agit de Victor Hugo qui, en orateur exceptionnel, prononce le 15 janvier un discours-fleuve pour éreinter le « parti clérical».
Le but auquel il faut atteindre, but éloigné, je le reconnais, ce but, le voici : l’instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire seulement pour le premier degré, gratuite pour tous. […]
Un immense enseignement public donné et réglé par l’État, partant de l’école de village et montant de degré en degré jusqu’au Collège de France, plus haut encore, jusqu’à l’Institut de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences ; partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu’il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. […]
En un mot, l’échelle de la connaissance humaine dressée fermement par la main de l’État, posée dans l’ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissant à la lumière. […]
J’entends maintenir […] cette antique et salutaire séparation de l’Église et de l’État, qui était la sagesse de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. […]
Je viens de vous dire ce que je voudrais ; maintenant, voici ce que je ne veux pas : je ne veux pas de la loi qu’on vous apporte.
Pourquoi ? Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n’est rien par elle-même ; elle n’existe que par la main qui la saisit. Or quelle est la main qui se saisira de cette loi ? Là est toute la question. Messieurs, c’est la main du parti clérical.
Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, j’entends qu’elles nous continuent. Voilà pourquoi je ne veux ni de votre main, ni de votre souffle sur elles. Je ne veux pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous ! Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte.
Je ne veux pas vous confier l’enseignement de la jeunesse, l’âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s’ouvrent à la vie, les générations nouvelles, c’est-à-dire l’avenir de la France. Je ne veux pas vous confier l’avenir de la France, parce que vous le confier, ce serait vous le livrer.»
S’ensuit un long passage durant lequel l’auteur des Misérables affirme sa foi catholique et se déclare favorable à l’instruction religieuse, mais demande qu’elle soit séparée de l’enseignement public :
« Je ne veux pas qu’une chaire envahisse l’autre ; je ne veux pas mêler le prêtre au professeur. […] Jusqu’au jour, que j’appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d’enseignement pourra être proclamée, […] je veux l’enseignement de l’Église en dedans de l’Église et non dehors. »
Soutenue par la droite conservatrice (avec à sa tête, Adolphe Thiers), la loi Falloux sera adoptée le 15 mars 1850, par 399 voix contre 237.
Vers l’institution de l’école gratuite obligatoire et laïque
 Les idées républicaines rencontrent le soutien de nombreux instituteurs, excédés par la soumission au clergé à laquelle les astreint la loi Falloux. Aussi l’anticléricalisme se répand-il dans le corps enseignant. La lutte contre l’influence cléricale apparaît d’autant plus nécessaire que la démocratie paraît inconciliable avec une Église catholique dont le caractère réactionnaire a été confirmé par le Syllabus de 1864, qui condamne toutes les idées modernes.
Les idées républicaines rencontrent le soutien de nombreux instituteurs, excédés par la soumission au clergé à laquelle les astreint la loi Falloux. Aussi l’anticléricalisme se répand-il dans le corps enseignant. La lutte contre l’influence cléricale apparaît d’autant plus nécessaire que la démocratie paraît inconciliable avec une Église catholique dont le caractère réactionnaire a été confirmé par le Syllabus de 1864, qui condamne toutes les idées modernes.
Peu après la commune, et considérant que l’Église représente une menace en cas de tentative de restauration monarchique, plusieurs républicains engagent un combat afin de limiter l’influence ecclésiastique sur la société, en commençant par l’école. Parmi les hommes politiques les plus actifs se trouve le ministre de l’Instruction publique du gouvernement Waddington, Jules Ferry. Dans son célèbre discours de la Salle Molière, il promet non seulement de consacrer toute son énergie à la question de l’éducation, mais aussi de retirer à l’Église son influence sur celle-ci, afin que la démocratie puisse vivre.
Il estime que la séparation de l’Église et de l’École doit précéder la séparation des Églises et de l’État : il importe d’abord d’émanciper l’opinion en lui apportant la science. La République est vue comme le régime de la fin de l’histoire, car la laïcité scolaire permettra de mettre un terme au conflit entre l’Ancien Régime et la Révolution qui n’a pas cessé depuis 1789. Aussi la politique républicaine est-elle une politique d’active laïcisation scolaire. Entre 1880 et 1886, les républicains prononceront successivement : la laïcisation du CSIP, le monopole de l’État de la collation des grades, que lui avait retiré la loi de1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur ; la gratuité de l’école publique, l’obligation de détention d’un brevet de capacité pour les instituteurs, la laïcisation des locaux et des programmes de l’école primaire, le caractère obligatoire de l’éducation pour les enfants des deux sexes, âgés de 6 à 13 ans, et la laïcisation du personnel des écoles primaires publiques.
Pour les fondateurs de l’école républicaine, la laïcité n’implique pas la neutralité politique. Jules Ferry ne s’en cache pas, qui déclare au Sénat, le 31 mai 1883 : « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n’avons pas promis la neutralité philosophique ou la neutralité politique ». L’engagement républicain est de rigueur et imprègne l’enseignement des écoles normales, véritables « séminaires laïques ». Au reste, la République étant aux yeux des pères de la Troisième République le seul régime conforme à la raison, cet engagement ne leur apparaît pas contradictoire avec le principe de laïcité : il s’agit toujours d’aider l’élève à se défaire des préjugés, pour le faire aboutir librement à l’idée de République. L’éducation civique, qui remplace l’éducation religieuse, y pourvoie. L’enseignement de l’histoire est également mis au service de l’apprentissage du sens civique et du patriotisme.
De la « liberté » d’enseignement au financement des écoles privées
Nombre de catholiques, toutefois, n’ont pas l’impression que la politique de laïcisation permette d’unir l’ensemble des Français. Ils ont au contraire le sentiment d’être persécutés. Car ils ne sauraient confier leur enfant à « l’école sans Dieu », qui ne peut manquer d’en faire des délinquants. Aux yeux des républicains positivistes, l’horizon de la politique laïque est la réconciliation et l’union des Français ; mais à court terme, la politique de laïcisation se traduit par la guerre des deux France. Dans les villages cléricaux, la « guerre scolaire » oppose enfants et parents de l’école libre et ceux de « la laïque ».
L’anticléricalisme est relancé au début du XXe siècle par l’Affaire Dreyfus. Les assomptionnistes du journal La Croix ont été parmi les antidreyfusards les plus virulents. Aussi, en 1904, toute activité d’enseignement, même dans les établissements libres, est-elle interdite aux congréganistes et l’accès au concours de l’agrégation est fermé aux ecclésiastiques.
En 1909, l’épiscopat français répond en publiant une lettre pastorale sur les droits et les devoirs des parents relatifs à l’école. Le principe de la laïcité est condamné et les parents catholiques sommés de confier leurs enfants à des écoles libres catholiques, sauf « motif sérieux ». Du moins faut-il exiger dans ce cas que la neutralité soit effectivement respectée et que les instituteurs publics n’outragent pas « la foi de leurs élèves ». Les parents d’élèves catholiques sont donc invités à former des associations pour surveiller les écoles publiques et exiger le retrait des manuels scolaires condamnés par l’épiscopat. Dans les régions les plus catholiques, des livres scolaires sont brûlés.
Dans cette « guerre des manuels », les pouvoirs publics se montrent fermes. En revanche, ils approuvent les réclamations de ceux qui, au nom du principe de neutralité de l’enseignement, dénoncent le glissement de certains instituteurs vers le socialisme et le pacifisme. Aussi bien, après 1905 et la loi de séparation de l’Église et de l’État, les luttes sociales tendent-elles à remplacer le combat anticlérical.
Pour les plus catholiques, puisqu’il est inconcevable de confier ses enfants à l’école sans Dieu, il n’est pas normal de payer des impôts qui servent à financer « la laïque ». Après avoir obtenu la « liberté d’enseignement », ils souhaitent donc obtenir le financement des écoles confessionnelles : le budget de l’État devrait comprendre une aide à l’enseignement privé en proportion du nombre d’élèves qu’il scolarise.
Après la chute de la Troisième République, le régime de Vichy s’en prend à la laïcité scolaire : les congrégations enseignantes sont de nouveau autorisées, les écoles normales sont supprimées, les devoirs envers Dieu, qui avaient été retirés des programmes de morale en 1923 sont réintroduits à l’école primaire (puis remplacés par la référence à la « civilisation chrétienne »). « Pour les fossoyeurs de la République, il était logique de s’attaquer d’abord à l’organe de reproduction et de perpétuation du régime déchu, l’école laïque ». Une aide financière exceptionnelle est versée à l’enseignement privé, sur la demande insistante d’un épiscopat qui approuve les principes de la Révolution nationale.
À la Libération, les valeurs laïques sont réaffirmées : « L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État », proclame en 1946 le préambule de la Constitution de la IVe République (préambule qui a été incorporé dans la Constitution de la Ve République en 1958).
Cependant, le poids du MRP, démocrate-chrétien, dans les coalitions gouvernementales conduit à l’adoption d’aides et de bourses à parité pour les élèves du privé et du public (lois Marie et Baranger en 1951). L’enseignement catholique désirait toutefois que soit apportée une aide aux établissements eux-mêmes. En 1959, la loi Debré tente de résoudre la querelle scolaire en acceptant le principe d’une aide aux établissements privés, à condition qu’ils passent un contrat avec l’État et acceptent son contrôle. Dans les établissements sous contrat, l’enseignement « doit être donné dans le respect total de la liberté de conscience » ; toutefois l’établissement conserve son « caractère propre ». Cette ambiguïté est insoutenable pour le camp laïque. Car même si les cours de catéchisme sont normalement facultatifs, cette loi paraît constituer une subvention indirecte à une religion.
En 1977, la loi Guermeur renforce le devoir de conformité des enseignants du privé au caractère propre de leur établissement. En 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir aurait dû voir la mise en place d’un grand service public unifié et laïque de l’Éducation nationale (SPULEN), mais le président de la République préfère céder aux manifestations des partisans de l’enseignement privé.
En 1993-1994, le camp laïque paraît prendre sa revanche quand il parvient à faire reculer le ministre François Bayrou, qui voulait accroître les aides à l’enseignement privé en supprimant les dispositions limitatives de la loi Falloux. Cependant il n’est plus question de revenir sur la loi Debré, et finalement, tout se passe comme si un équilibre avait été trouvé.
La querelle scolaire était en effet liée à la question du régime politique : si l’école de la République, c’était la laïque, c’est parce que le monde catholique paraissait refuser, sinon la République, du moins ses valeurs. La satisfaction éprouvée par l’épiscopat lors de l’établissement du régime de Vichy semblait confirmer la nécessité d’associer République et laïcité. Cependant l’Église catholique évolue. Avec le Concile de Vatican II, elle paraît se réconcilier avec les valeurs du monde moderne. En 1969, l’épiscopat français adopte une nouvelle doctrine scolaire qui reconnaît la contribution de l’école publique. Dans ces conditions, l’anticléricalisme perd de sa force et de sa vigueur, et n’apparaît plus consubstantiel de la République.
Au demeurant, la sécularisation de la société a rendu moins cruciale la vieille querelle scolaire. La clientèle des écoles privées est de moins en moins motivée par l’appartenance religieuse. Pour la majorité des parents, l’école privée est davantage un recours contre les carences réelles ou supposées de l’école publique qu’un outil d’éducation religieuse.
La destruction de l’école républicaine sous la Vème république
Au-delà de la soumission des élèves à l’enseignement religieux, la « querelle scolaire » renvoyait également à une opposition entre deux conceptions de ce que devrait être l’instruction, et donc l’école. D’une part, la conception républicaine : l’école doit être un facteur de Liberté et conduire à l‘autonomie de l’individu. Et d’autre part le modèle adaptatif : adapter l’individu à la société.
Selon le rapport de force entre ses tenants : le Peuple, autour du mouvement ouvrier, lié le plus souvent à la petite bourgeoisie républicaine, radicale, progressiste, autour du modèle républicain, l’Eglise et le Patronat autour du modèle adaptatif, des mesures sont prises dans un sens ou dans l’autre.
Au profit de l’importation progressive d’un modèle culturel anglo-saxon dominant dans l’après-guerre, d’une construction européenne basée sur un modèle économique libéral puis néo libéral, et de l’affirmation de la primauté de la recherche de l’équilibre budgétaire sur tout autre objectif politique, le rapport de force penche depuis la seconde guerre mondiale en faveur des tenants du modèle adaptatif. Il n’est dès lors plu étonnant de voir fleurir divers natures de critiques contre l’école républicaine : son coût trop élevé, son élitisme, son inadéquation aux besoins du monde du travail, bref, son inefficacité globale.
Réformes institutionnelles avec la loi Debré de 1959 qui vise à donner une place bien plus importante à l’enseignement privé, réformes des programmes et de l’organisation des cycles avec la réforme Fouchet du collège qui crée les CES et aboutira en 1975 au collège unique de René Haby. Réformes pédagogiques et réformes des contenus de l’enseignement et des objectifs que doit se donner l’école. Réforme de l’organisation de l’enseignement par l’autonomisation progressive des niveaux successifs.
Il serait fastidieux d’énumérer la liste de ces réformes qui s’additionnent les unes aux autres, mais il est en revanche tout à fait remarquable que la direction globale de ces réformes n’a pas été infléchie par les changements de couleur des gouvernements au fil de la Vème république.
Si cela se conçoit aisément venant de la « droite », la non remise en cause des réformes passées par les gouvernements de « gauche » s’explique notamment par le recoupage entre le clivage « républicain » / « pédagogues » et le clivage entre jacobins et « seconde gauche ». Celle-ci récuse l’universalisme abstrait qui fondait la conception républicaine de la citoyenneté, mais avait selon elle permis d’occulter l’exclusion des femmes de la vie politique et de justifier la colonisation. Elle cherche donc à concilier citoyenneté et identités, y compris religieuses, ce qui se traduit par une conception « plurielle » de la laïcité. Le « consumérisme », qu’elle constate et auquel elle souhaite donc s’adapter, traduirait la mort des grandes idéologies, dont faisait partie l’idéologie républicaine.
Dans ces réformes, le but affiché est de promouvoir plus d’égalité, plus de « démocratie » dans un système réputé élitiste. On poursuit l’objectif de la « réussite scolaire » pour tous. Elles rassurent en promettant de « libérer l’enfant », combattre « l’école sanctuaire », « ouvrir l’école », « mettre l’élève au centre du système éducatif ». Elles proclament la nécessité d’en finir avec les discriminations sociales, et d’adapter l’école à la réalité de la société d’aujourd’hui. Pour atteindre ces objectifs, il faut en finir avec les expériences identifiées par les experts en sciences de l’éducation comme traumatisantes pour l’enfant, et notamment toutes les situations de mise en infériorité présumée de l’élève au premier titre des quels l’acte d’apprentissage explicite comme le cours magistral, remettant de facto en cause les connaissances académiques. Et de se référer régulièrement à l’expression de Montaigne, en préférant les têtes bien faites aux têtes bien pleines … au risque d’oublier que le plus brillant des esprits ne peut raisonner correctement sans un bagage de connaissances suffisant.
Tirant la pelote de la remise en cause du savoir académique, ces réformes revisitent tout ce qui lui était lié : des disciplines ou les matières, au rapport professeur-discipline-classe en passant par les notes, (trop traumatisantes pour l’élève, auxquelles on va faire succéder l’évaluation des compétences, prémices du monde de l’entreprise), le redoublement ou les cadres nationaux (que ce soit en matière de programme des diplômes, du fonctionnement des établissements ou des statuts des enseignants).
Aux savoirs « abstraits » sont ainsi substitués des apprentissages « concrets » permettant à l’élève de s’exprimer. Grâce au potentiel identifié dans les nouvelles technologies, l’élève n’a plus besoin de professeur. L’ordinateur adapte le contenu et le support d’apprentissage en fonction des besoins pédagogiques de l’apprenant, ainsi que de son niveau de compréhension du sujet traité, et sa façon d’apprendre. Le professeur devient une « personne ressource » qui pourra être consultée par l’apprenant quand il en éprouvera le besoin au cours du processus de « construction de son savoir », concrétisation du modèle adaptatif et de son principe de « l’élève-au-centre.
Mais les résultats obtenus ont de quoi laisser dubitatifs.
- On réduit inexorablement les programmes : Chacun peut constater en se confrontant aux anales des examens et concours la chute progressive du niveau. Il se dit même que, selon les disciplines, les élèves de 5e ont maintenant le niveau des élèves de CM1 de 1987.
- On supprime postes et heures de cours.
- Après les avoir progressivement vidés de leur sens (notamment les ayant rendu moins sélectifs et donc in fine sans valeur), on prône la suppression des examens, et des diplômes (CAP, BAC).
- Le but, est celui de l’adaptation de l’individu au besoin immédiat du marché du travail (l’employabilité). On privilégie l’acquisition de compétences immédiatement utilisables au détriment de l’acquisition initiale de la hauteur de vue basée sur des connaissances méthodologiques et théoriques larges permettant ultérieurement l’acquisition aisée des compétences complémentaires afin de répondre à ses besoins professionnels non seulement immédiatement post scolarité mais tout au long de la vie.
Pendant longtemps, le capital a eu besoin d’une main-d’œuvre ayant un minimum d’instruction. C’est pourquoi il a, un peu partout, organisé une formation élémentaire de sa future « force de travail ». Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les idéologues et autres marchands de sommeil vantent « l’économie de l’intelligence ». Mais le mode de production capitaliste a dépassé le stade où il avait un besoin massif d’ouvriers qualifiés et d’ingénieurs. La grande transformation de la fin du XXe siècle a été celle de la catastrophe industrielle dans les pays avancés : des millions d’emplois supprimés par l’automatisation dans l’industrie, constructions mécaniques, électronique grand public, etc et transfert pour partie de ces emplois dans les pays émergents. Les emplois supprimés ont été principalement des emplois ouvriers. La classe ouvrière a chanté son chant du cygne dans les années 70 et elle a été invitée à quitter la scène pour laisser place aux « nouvelles classes moyennes » intellectuelles du secteur tertiaire. Mais aujourd’hui, cette nouvelle classe moyenne est à son tour dans le collimateur des modernisateurs. Tout le secteur des services commence à être massivement touché par les suppressions d’emplois et délocalisations.
Le capital a besoin de petites mains taillables et corvéables à merci, de petites mains « uberisées » et non plus d’une classe de salariés qui pourraient s’appuyer sur la possession d’un métier et d’une solide qualification. Sans doute une élite possédant une solide formation technique et scientifique reste nécessaire, mais celle-ci n’est pas très nombreuse.
Dès les années 90, l’OCDE annonçait la couleur. En 1996, un rapport de l’institution indiquait la marche à suivre pour en finir avec une instruction réelle : diminuer la qualité sans diminuer la quantité.
« Si l’on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la population. »
Ou encore
« les pouvoirs publics n’auront plus qu’à assurer l’accès à l’apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l’exclusion de la société en général s’accentuera à mesure que d’autres vont continuer à progresser ».
En relisant aujourd’hui ces textes, on a l’impression d’avoir la description exacte des politiques mises en œuvre sur le demi siècle écoulé, et que cette politique découle de la dynamique même du mode de production capitaliste.
Franc maçons du Grand Orient de France, nous réaffirmons notre attachement au modèle républicain de l’éducation, fabrique d’hommes et de femmes libres car instruits.
Sources :
https://journals.openedition.org/trema/2732
http://la-sociale.viabloga.com/news/ecole-la-pire-de-toutes-les-reformes



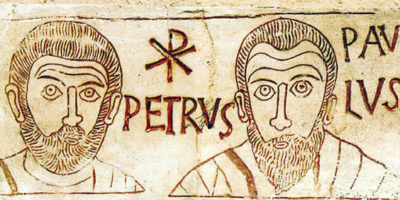
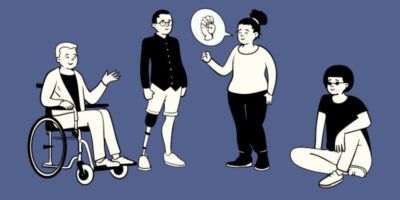

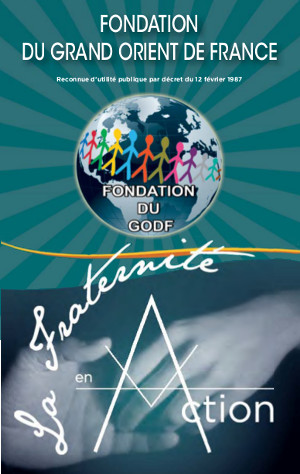

Leave a Reply