 Réjouissons-nous : la France a changé. Fini le temps où des hordes de barbares s’agglutinaient dans les rues, au mépris de l’ordre public, pour arracher des avantages sociaux ou conforter des privilèges. Derrière nous l’époque archaïque où quelques illuminés se plaisaient à séquestrer des Directeurs de Caisses de Sécurité Sociale, et je ne vise personne en particulier…
Réjouissons-nous : la France a changé. Fini le temps où des hordes de barbares s’agglutinaient dans les rues, au mépris de l’ordre public, pour arracher des avantages sociaux ou conforter des privilèges. Derrière nous l’époque archaïque où quelques illuminés se plaisaient à séquestrer des Directeurs de Caisses de Sécurité Sociale, et je ne vise personne en particulier…
Les Français sont devenus raisonnables ! En tout cas, ils ne se mobilisent plus comme par le passé et de nombreuses études le démontrent. Le sociologue Hirschman a identifié à partir des années 70 trois grandes options pour le salarié face à un problème :
-
Le prise de parole, c’est-à-dire l’action individuelle ou collective, voire le mouvement social
-
La défection, le fait de quitter l’entreprise
-
La loyauté dans le cas ou l’attachement à l’entreprise prend le pas sur la volonté individuelle de mobilisation
Manifestement, la défection ou la loyauté semblent désormais dominer majoritairement le comportement des acteurs. Le paradoxe, c’est que cette conflictualité apparemment en retrait s’accompagne de l’émergence ponctuelle de mouvements violents, s’appuyant le cas échéant sur la contrainte physique ou des menaces écologiques, ou, dans les situations les plus aiguës, de vagues de suicides dans quelque grande entreprise. Tous ces phénomènes contemporains traduisent à la fois la souffrance et la révolte qui imprègnent encore aujourd’hui le monde du travail.
Avec la montée du chômage de masse, Hirschman et ses successeurs ont ajouté une quatrième option : l’apathie. La peur du chômage conduit chacun à rester prudent et à ne s’associer à aucune action collective qui pourrait lui porter préjudice. Ainsi, l’absence de conflit, que l’on peut définir comme un mouvement explicite d’opposition ou de revendication, ne saurait être identifiée comme la preuve d’une certaine maturité dans la régulation sociale, mais elle révèle au contraire une plus forte rigidité des rapports sociaux pouvant entraîner de grandes frustrations et l’éclatement, exceptionnel mais intense, de conflits violents.
Aujourd’hui, il me semble que personne ne considère que la tendance à la réduction du nombre et de l’ampleur des mouvements sociaux traduit un bien être généralisé. Au contraire, deux interprétations de ce mouvement retiennent l’attention : l’une pessimiste et l’autre très pessimiste. La lecture pessimiste consiste à dire que la tertiarisation des économies a engendré la disparition de l’usine, berceau des grandes luttes sociales, au profit d’entités plus réduites et disséminées entre lesquelles la mobilisation est plus difficile à organiser. La lecture très pessimiste prétend que les nouvelles modalités de management des entreprises, en individualisant les rémunérations et les carrières, en introduisant de nouvelles méthodes de travail fondées sur le « juste-à-temps » et la polyvalence, a non seulement détruit les solidarités professionnelles et leur pouvoir de mobilisation, mais surtout a introduit une emprise psychologique inédite chez le salarié, placé en situation de « servitude volontaire » pour reprendre l’expression de Jean-Pierre Durand.
Sans remettre en cause de façon définitive l’une ou l’autre de ces lectures, je souhaite aujourd’hui attirer l’attention sur le fait que, contrairement aux apparences, il me semble que les conflits n’ont pas disparu et qu’au contraire ils s’adaptent aux réalités du temps. J’évoquerai d’abord l’évolution du nombre de conflits sociaux, qui recouvre une réalité plus contrastée qu’il n’y paraît, avant de revenir sur la recomposition en cours des conflits dans le monde du travail.
-
L’évolution du nombre de conflits sociaux : une réalité complexe
-
Les grèves en repli depuis près de 40 ans.
Le constat selon lequel les conflits sociaux sont en net recul s’appuie principalement sur l’évolution des grèves, ou plus précisément sur le nombre de JINT, (journées individuelles non travaillées), qui est l’indicateur reconnu et repris dans les publications officielles. J’aurai l’occasion un peu plus tard de revenir sur la pertinence de cet indicateur.
A première vue, les chiffres sont sans appel : plus de 3 millions de JINT dans les années 1970, contre 250 000 à 500 000 aujourd’hui. Il s’agit d’une tendance de fond, à peine contrariée par quelques soubresauts au moment des grandes réformes sociales (grèves de 1995, réforme des retraites en 2003 et 2008, instauration du CPE. La grève semble donc se marginaliser, ne concernant que les mouvements interprofessionnels d’ampleur nationale, et principalement les salariés du secteur public, protégés par un statut ou, à tout le moins, un univers non concurrentiel.
-
Des conflits institutionnalisés
Cette tendance globale peut se comprendre dans un mouvement général de pacification et d’institutionnalisation des conflits sociaux. D’ailleurs, la pensée libérale n’a jamais réellement compris l’organisation des mouvements revendicatifs. Postulant des individus rationnellement mus par leur propre intérêt, elle se heurte au « paradoxe d’Olson », qui veut que chacun a intérêt à ce qu’un mouvement social aboutisse puisqu’il profitera à tous, mais que personne n’a individuellement intérêt à y participer au regard du coût qu’il représente en temps et en argent (jours de grève non rémunérés). Finalement, le mouvement collectif s’apparente par un phénomène de pression du groupe sur les individus, et peut vite dériver sur des phénomènes de manipulation par un leader charismatique. Le déclin des grands mouvements de grève n’est donc rien d’autre que la prise de conscience rationnelle des individus de ce qui constitue leur intérêt.
Sans tomber dans la caricature, force est de reconnaître que les sociétés modernes ont mis en place des soupapes qui permettent de réguler les conflits sectoriels sans passer par un mouvement de grève de grande ampleur et/ou violent. Historiquement, l’émergence des grands mouvements sociaux est concomitante de la nationalisation de la vie politique française, plaçant l’Etat comme le principal régulateur de la vie sociale, et de la révolution industrielle qui entraîne à la fois le regroupement des populations et l’apparition de moyens de communications nouveaux. Si le XIXème siècle est marqué par des conflits massifs et parfois violents passant notamment par le mouvement luddiste, qui repose sur la destruction des machines, les périodes récentes marquent une tentative de canaliser et de pacifier les négociations sociales. C’est vrai sur le plan juridique avec la reconnaissance du droit de grève comme un droit constitutionnel en 1946, et toute la jurisprudence qui en découle sur la conciliation entre le droit de la grève et l’exigence de continuité dans les services publics. C’est vrai également sur le plan institutionnel avec la professionnalisation et la reconnaissance de la négociation sociale. Il existe désormais des professionnels de la négociation, habilités sous certaines conditions à valider des accords, qui ouvrent d’autres perspectives que la simple grève.
Plus globalement, il ne faut pas négliger l’impact de l’évolution sociale du monde du travail sur les modalités d’exercice des conflits. Le sociologue Inglehart parle de la « Révolution silencieuse » (1977). Il reprend la pyramide de Maslow, qui définit, par ordre de priorité, les besoins de l’individu et montre comment le monde du travail a progressivement répondu à ces besoins exprimés :
-
Les besoins organiques et de sécurité sont couverts par les augmentations de salaires depuis la mise en place du fordisme
-
Le besoin d’appartenance est couvert par les modes d’organisation développées notamment au Japon et qui insèrent l’individu dans des groupes au sein de l’entreprise et en marge de celle-ci (cours de gymnastique,…)
-
Le besoin d’estime de soi trouve un écho dans les thématiques du management « moderne » prônant la prise de responsabilité, l’autonomie dans le travail et la créativité
Reste le besoin de réalisation, d’épanouissement personnel, qui ne peut être satisfait que par des revendications qui touchent le monde du travail de façon plus marginale. Je ne souhaite pas me prononcer définitivement sur la question de savoir si la gestion actuelle des entreprises correspond effectivement à la satisfaction de ces différents besoins. Ce qui me semble intéressant dans la théorie d’Inglehart, c’est de comprendre l’émergence de nouvelles revendications sociales, qui porte sur des thématiques inédites. Pour schématiser, les principaux besoins de l’individu étant actuellement couverts dans le cadre de l’activité professionnelle, il est logique que les revendications se déplacent sur des champs différents de l’augmentation des salaires. D’où la montée en puissance de revendications plus culturelles, voire communautaires (régularisation des sans papiers, promotion des droits des homosexuels,…).
Alain Touraine reprend une thématique proche en parlant du passage à une société post-industrielle dans laquelle le conflit social change de nature pour se concentrer sur les aspects culturels et la maîtrise de l’information.
-
L’évolution du nombre de conflits : une réalité contrastée
Il serait cependant trop rapide de déduire de ce qui précède que le reflux des mouvements de grèves signifie que la conflictualité est elle-même en recul dans le monde du travail. En premier lieu, l’actualité nous permet d’observer régulièrement des mouvements d’ampleur, même s’ils se trouvent plus catégoriels : chauffeurs routiers, convoyeurs de fonds, caissières de supermarché. Il apparaît également que selon les critères envisagés, la conflictualité dans le monde du travail connaît une certaine progression. Ainsi, le livre La lutte continue, publié en 2008, permet d’examiner plus précisément cette conflictualité. Les auteurs analysent cette évolution à travers une enquête qualitative diligentée par le Ministère du Travail, intitulée REPONSE (Relations professionnelles et négociations d’entreprise) qui donne une photographie de la situation sociale des entreprises, et réalisée en 1993, 1998, et 2004.
Il apparaît à la lecture de ces études que la proportion d’entreprises touchées par au moins une forme de conflit social croît considérablement entre 1998 et 2004 : de 21% sur la période 1996-1998 à 30% sur la période 2002-2004. On constate également que sur la même période, de nouveaux types de conflits émergent, parallèlement aux mouvements de grèves : débrayages (10% d’entreprises concernées en 2004 contre 7.5% en 1998), grève du zèle, pétitions et surtout refus de réaliser des heures supplémentaires (3.2% d’entreprises concernées en 1998, contre 9.6% en 2004).
Les auteurs invitent même à nuancer le regard porté à l’évolution des grèves, pour ce qui concerne les mouvements de courte durée. Si moins d’entreprises déclarent avoir connu des grèves supérieures à 2 jours, des mouvements de durée inférieure ont concerné 10% des établissements en 2004 contre 7.5% en 1998. Autrement dit, la mesure de la permanence de conflits sociaux ne saurait se résumer à l’évolution du nombre de jours de grèves sur une année.
L’ouvrage cité permet dès lors d’établir les critères qui déterminent le degré de conflictualité. Si l’industrie reste particulièrement marquée (30% à 40% des établissements touchés par un conflit), il semble que la variable déterminante soit davantage le nombre de salariés : 75% des entreprises de plus de 500 salariés touchées en 2004, contre 23% dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ainsi, la prégnance historique d’une culture ouvrière semble moins déterminante que le nombre de salariés en capacité de se mobiliser : les banques, qui ne font pas partie du monde industriel, sont pourtant parmi les entreprises les plus touchées (41%). Par ailleurs, la présence d’organisations syndicales dans l’établissement constitue également une variable essentielle. Enfin, dans les petites entreprises, l’évolution se caractérise par une individualisation plus grande des conflits : 50% des entreprises de moins de 50 salariés indiquent avoir prononcé des sanctions à 3% du personnel, alors que 20% des entreprises de plus de 500 salariés font la même déclaration.
Ainsi, la conflictualité du monde du travail ne doit pas être analysée exclusivement à l’aune de l’évolution du nombre jours de grève ou de la raréfaction des grands mouvements nationaux. Il convient de parler davantage d’une conflictualité en recomposition.
-
Des conflits sociaux en recomposition
-
Le conflit au cœur des rapports sociaux
Si la conflictualité a pu trouver, pour s’exprimer, de nouveaux vecteurs de régulation, si elle a investi de nouveaux champs de revendications, elle n’en reste pas moins présente dans le fonctionnement quotidien d’une société moderne. Sans revenir en détail sur l’apport fondamental de la théorie marxiste de la lutte des classes, ce dont je serai bien incapable, il semble cependant utile de rappeler ici la tradition des penseurs, philosophes ou sociologues, qui ont livré une analyse approfondie des rapports sociaux en les appuyant sur une lutte permanente entre dominants et dominés.
Si Marx a sans doute acquis la plus grande notoriété en la matière, il convient de citer les théories de Dahrendorf ou même de Bourdieu qui tentent de démontrer comment, même dans une société moderne, une lutte permanente s’instaure entre ceux qui ont un intérêt objectif au conservatisme, et ceux qui se mobilisent pour obtenir davantage. L’apport des sociologues modernes étant notamment d’insister sur le fait que ces conflits entre intérêts divergents dépassent le champ du monde industriel et de l’économie pour gagner l’ensemble des secteurs de la vie sociale (culture, maîtrise et diffusion de l’information,…).
A la lumière de ces analyses, il convient d’ailleurs de signaler que la reconnaissance de l’existence et de la permanence des conflits sociaux est elle-même un enjeu de lutte.
-
La reconnaissance du conflit est elle-même un enjeu de lutte
C’est le second intérêt de l’ouvrage La lutte continue, qui livre une critique assez fine de l’indicateur universellement retenu pour mesurer l’existence de conflits sociaux, à savoir l’évolution du nombre de Journées Individuelles Non Travaillées (JINT) publié par la DARES. Les auteurs montrent que le fait même de considérer cet indicateur comme pertinent emporte une représentation sociale biaisée, à travers trois principaux arguments.
En premier lieu, cet indicateur concentre des données statistiques variables dans le temps, comme la prise en compte des débrayages, c’est-à-dire les arrêts de travail de moins d’une heure ou de moins d’une journée. A priori, les arrêts de travail sont comptabilisés lorsque le volume d’heures chômées (en prenant le nombre total de grévistes), dans un établissement, est supérieur à 8 heures, c’est-à-dire une journée moyenne de travail. Autrement dit, si 7 grévistes débrayent une heure chacun, ce mouvement n’est pas comptabilisé. Plus important encore, les débrayages étaient explicitement intégrés aux enquêtes de la DARES en précisant ce mode de comptabilisation. Depuis les années 1990, aucune mention n’est inscrite, ce qui invite à penser que ces éléments ne sont plus pris en compte aujourd’hui.
En second lieu, le champ des établissements concernés par les JINT a lui aussi évolué dans le temps. Jusqu’en 2001, il concernait l’ensemble du secteur privé (hors agriculture) et les entreprises publiques ou nationalisées, à l’exclusion donc de la fonction publique. En 2003, il se réduit au seul secteur privé, les données relatives aux transports, à La Poste, à EDF-GDF ou à la SNCF ne faisant plus partie de l’étude et étant prises en charge par les Ministères des Transports et de la Fonction Publique, qui sont chargés d’établir leurs propres statistiques. Or, les modes de comptabilisation divergent entre les différents organismes.
Enfin, les modes de repérage et de dénombrement des JINT restent très aléatoires. Légalement, les inspecteurs du travail doivent signaler systématiquement les journées de conflit. Pour autant, au regard de leur nombre et de la multiplicité des missions qui leur sont confiées, il est possible de douter de l’exhaustivité de ce recensement. Des études spécifiques ont d’ailleurs été conduites à ce sujet, qui démontrent que 84% des entreprises ayant établi une déclaration de conflit dans l’enquête REPONSE n’ont fait l’objet d’aucun signalement par l’Inspection du Travail. Ces divergences statistiques sont particulièrement marquées dans les petits établissements et au sujet des conflits courts.
Bref, la qualité et la fiabilité des statistiques disponibles laissent planer un doute sur leur exactitude, alors que l’on devine aisément que personne n’a intérêt à admettre que les arrêts de travail sont la forme normale de régulation des conflits à l’heure où l’on promeut la culture de la négociation.
-
De nouveaux répertoires d’actions
S’il n’est donc pas possible de trancher définitivement sur le nombre absolu de jours de grève, il n’en reste pas moins que le champ de la contestation et du conflit social a désormais élargi les répertoires d’actions traditionnels. Et il me semble que, loin de valider la logique d’une « servitude volontaire », ces nouveaux modes de contestation sociale traduisent au contraire la permanence et l’actualité du conflit social.
Rappelons tout d’abord que les actions de « résistance au travail », c’est-à-dire de rébellion face aux injonctions de la hiérarchie sont une constante de l’analyse sociologique des entreprises. Dès les années 1930, Mayo décrit, dans la Western Electric, une organisation parallèle et informelle, s’appuyant sur des relations interpersonnelles, des croyances et des pratiques qui se caractérisent par d’importantes résistances au changement et des actions contradictoires avec le but économique de l’entreprise.
Même dans un contexte marqué par l’individualisation des relations de travail (rémunération, promotions), la production en juste-à-temps et les cercles de qualité, il serait imprudent de considérer que cette tendance générale à la contestation a pu disparaître. Face à un management nouveau, des positionnements inédits apparaissent. Le sociologue Christian Thuderoz analyse ces évolutions de positionnement à travers trois critères :
-
La forme de contrôle exercé sur les salariés : s’agit-il d’un « assujettissement » comme dans l’organisation taylorienne, ou d’une recherche de responsabilisation du salarié ?
-
L’intensité de l’opposition au travail
-
L’intensité de l’engagement du salarié dans sa vie professionnelle
Les formes actuelles de management entraînent des pratiques nouvelles de résistance. Je ne prendrai qu’un exemple pour illustrer le propos. Prenons le cas d’une opposition forte à l’organisation du travail. Hier, cette situation se traduisait par une capacité des acteurs à réguler eux-mêmes, plutôt à la baisse, le niveau d’activité. C’est ce que l’auteur appelle la « récalcitrance ». Les formes actuelles de management par la responsabilisation transforment la « récalcitrance » en comportements de « rébellion », c’est-à-dire des actes individuels d’opposition ouverte avec la hiérarchie. La rébellion se traduit par exemple par le renseignement erroné des statistiques de production, ou le refus exprimé par le monde enseignant d’appliquer les directives du Ministre Xavier Darcos.
L’environnement professionnel des consultants offre une autre illustration de ce phénomène de rébellion. Dans une entreprise où tout pousse le salarié à donner le maximum, et même un peu plus, où la rémunération et les perspectives sont particulièrement attractives, les salariés semblent accepter les injonctions contradictoires, le fait de mener des projets qui ne correspondent en rien à son domaine d’expertise. Pourtant, les consultants ont mis en place un forum en ligne où chacun peut, anonymement, déposer des caricatures qui brocardent le management et mettent à jour les contradictions de l’entreprise.
Mieux, il semble même que les salariés sont capables de mobiliser les compétences exigées par le management « moderne » pour bâtir de nouvelles actions de contestation. Ainsi, la promotion du travail en réseau, l’autonomie, l’accent mis sur les échanges d’informations ont été récemment mis à profit par les commerciaux de la société Générali, pourtant éparpillés sur le territoire, pour refuser collectivement la signature de nouveaux avenants aux contrats de travail, dont ils considèrent qu’ils leur impose une forme de vente forcée.
Les organisations modernes et les pratiques contemporaines de management n’auraient donc pas pour conséquence de détruire les capacités de contestation des individus dans le monde du travail, mais ouvrent la perspective de renouveler le répertoire d’actions des contestataires. Pour autant, deux nuances méritent d’être apportées :
En premier lieu, les actions de rébellion ou de distance affichée avec la hiérarchie, ne remettent pas profondément en cause les pratiques managériales, mais semblent plutôt des dispositif de survie du salarié dans un univers particulièrement exigeant. Par ailleurs, les auteurs montrent que lorsque l’opposition au travail et l’engagement professionnel du salarié sont forts, la « militance » de l’ouvrier taylorien, appuyée sur des représentants syndicaux, se transforme en « renoncement », pouvant déboucher sur des situations de détresse et d’isolement particulièrement aigus. Lorsque les salariés qui ont voulu croire au discours de la modernité et participer au système se sentent trahis, se développe un sentiment d’injustice qui est le moteur principal des actions violentes et qui, dans des formes exacerbées, poussent le salarié à retourner cette violence contre lui.
Conclusion
La lutte sociale traditionnelle semble effectivement se marginaliser au profit de conflits nouveaux dans leurs revendications, plus culturelles et sociétales, comme dans leurs modalités, plus diverses (pétitions, débrayages,…). Si la question du nombre de mouvements sociaux reste polémique, chacun reconnaît que des phénomènes originaux se développent : on a ainsi pu parler de grèves par procuration à partir de 1995, lorsque les salariés du privé témoignent de leur soutien à un mouvement initié et tenu par le secteur public. De même, les réformes successives des régimes de retraite ont permis de mesurer cette tendance à travers l’évolution du ratio grévistes/manifestants, témoignant de l’élargissement de la palette d’actions des individus.
La contrepartie de cette recomposition des mouvements sociaux, c’est une évolution vers des luttes défensives (préservation des acquis) et non revendicatives, des luttes éparpillées et non massives. Hier, la pénibilité et la souffrance au travail étaient vécues sur un mode collectif et débouchaient sur des revendications. Elles sont désormais plus individualisées, souvent interprétées par le salarié comme de la malchance, ou pire, la preuve objective d’un manque de compétence.
Alors la lutte continue, certes, mais est-elle encore efficace en comparaison des grands mouvements historiques reposant principalement sur les grèves ? Je crois qu’il faut nous réjouir de la préservation de ces réflexes de résistance et d’innovation, de cette capacité à retourner le système contre lui-même en s’appuyant sur les contraintes contemporaines pour élaborer de nouvelles formes de revendications et innover dans les actions menées. Et il faut surtout nous méfier du regard nostalgique que nous pouvons spontanément porter sur les grands mouvements de grève d’autrefois, en rappelant ce que Coluche en disait lui-même il y a plus de 30 ans.



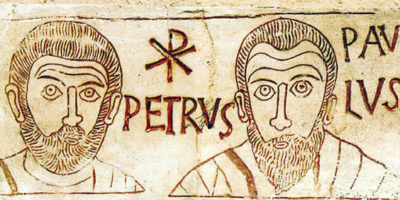
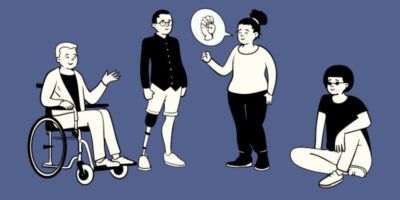

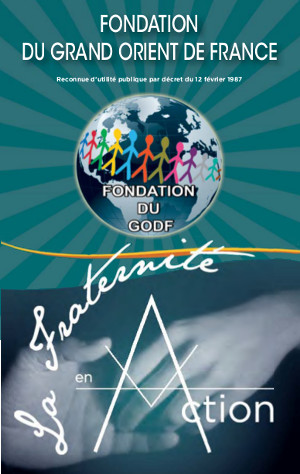

Leave a Reply