 Mes activités professionnelles m’ont donné l’occasion d’assister à plusieurs séminaires, dont l’un portait sur les évolutions possible de l’utilisation de l’argent, et principalement des espèces. Au cours de celui-ci, le débat faisait rage entre ceux qui positionnaient l’utilisation des espèces sur une tendance nécessairement baissière et ceux qui voyaient dans le cash un roi dont il serait impossible d’enlever la couronne.
Mes activités professionnelles m’ont donné l’occasion d’assister à plusieurs séminaires, dont l’un portait sur les évolutions possible de l’utilisation de l’argent, et principalement des espèces. Au cours de celui-ci, le débat faisait rage entre ceux qui positionnaient l’utilisation des espèces sur une tendance nécessairement baissière et ceux qui voyaient dans le cash un roi dont il serait impossible d’enlever la couronne.
Les premiers arguaient de raisons principalement éthiques : la consubstantialité du cash à l’économie parallèle serait une raison suffisante pour que les institutions de l’Union Européenne s’attèlent à sa réglementation, ce qui engendrerait nécessairement une diminution de son utilisation au profit de moyens de paiement plus facilement traçables tels la carte de paiement ou le virement. Les seconds misaient sur plusieurs facteurs : une certaine forme de continuité (plus de 9 transactions sur 10 au niveau Européen sont à ce jour réalisées en espèces), la nécessité pour les institutions de protéger leur monnaie (ce qui leur interdisait de facto d’en limiter l’acceptation, et donc l’usage), l’opposition entre argent publique (le cash) et argent privé (cartes de crédits) et surtout le fait qu’en temps de crise, le cash était la valeur refuge.
Afin d’étayer ce dernier point, un des orateurs s’appuyait sur les exemples de Northern Rock, Royal Bank of Scotland, et d’autres pour montrer que le cash avait parfaitement joué son rôle dans la crise qui était selon lui plus ou moins derrière nous : en assurant la disponibilité d’espèces en toute circonstance et dans tous les établissements, la filière cash a évité les mouvements de panique, a maintenu le système, et l’a empêché de s’écrouler. Ainsi était-il, selon lui, suicidaire de vouloir se séparer d’un instrument de stabilité, et ce d’autant (sic!) que les crises seraient comme les tremblements de terre (nous ne pouvons les éviter et il faut donc apprendre à en limiter les effets) et que le cash serait, dans ce concept, comparable à un matelas qui serait notre meilleure protection contre les tremblements de terre.
L’utilisation par le lobbysite en chef de l’association européenne des transporteurs de fond du bon vieux coup de l’incarnation de l’intérêt général par ses propres intérêts particuliers m’arracha forcément un sourire en coin. Mais plus encore, c’est cette affirmation, qui ne fut remise en cause par personne, que les crises étaient inévitables, quasiment un état normal du système, qui me faisait tiquer. N’y a-t-il donc vraiment rien à apprendre des crises passées qui nous permettrait de nous prémunir de leur résurgence dans le futur? Les crises ne sont pourtant pas suspendues dans le vide. Elles ne se cantonnent jamais à leur seul sphère de survenance. Elles engendrent des dégâts au delà de leurs seuls responsables directs et indirects. Naissant dans le domaine financier, elles y détruisent des milliards en monnaie virtuelle et font dégringoler les cours de bourses avant de contaminer rapidement le secteur économique. Les carnets de commande se vident, les machines ralentissent, les plans sociaux arrivent. Jetant des millions de personnes dans la pauvreté, c’est l’ensemble du secteur social qui est à ce stade touché. Les politiques menées sont alors mises en question par les peuples. Le mouvement social s’organise, et la tension contamine le monde politique. En fonction de l’ampleur de ces tensions, celles-ci peuvent gagner des blocs géopolitiques, ouvrant la porte aux confrontations de peuples non plus sur le champs économique, mais bien réel… N’est-il pas dés lors de la responsabilité collective que d’essayer d’apprendre du passé pour améliorer le futur? Humblement, et bien que je ne sois économiste ni de formation ni de profession, ni même de passion, c’est ce débat que je souhaite porter devant vous. A cette fin, je m’appuierai principalement sur l’analyse de la tristement célèbre crise des subprimes, avant d’ouvrir le débat en vous soumettant quelques pistes de réflexion.
La crise actuelle a pour point de départ l’éclatement de la bulle spéculative de l’immobilier américain, symbolisé par les fameux crédits subprimes. Pour continuer notre analyse, je vous propose un voyage au sein du système immobilier américain afin de poursuivre notre tour des mauvaises pratiques dont il est nécessaire de se départir pour prévenir la résurgence de crises.
Comme cela nous a été répété en de nombreuses occasions, et notamment lors de la dernière campagne présidentielle, à la différence de la France, les Etats Unis sont une nation de propriétaires. 70 % des Américains étaient ainsi propriétaires de leur logement en 2007, contre « seulement » 56% en France. Cela n’est évidemment pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix politiques favorisant l’accession à la propriété. Ils correspondent à l’histoire spécifique de ce pays, où dés la conquête de l’ouest, chacun était autorisé, invité, à prendre possession d’ une terre pour y construire son ranch. Politiquement parlant, ils se concrétisent au niveau législatif à partir du new deal. Le National Housing Act de 1934 instaure ainsi la garantie par l’Etat des prêts consentis. Les instruments de l’application de cette politique sont créés en 1938 par la fondation de Fannie Mae (entreprise qui achète et sécurise les prêts immobiliers afin de fournir les liquidités aux organismes qui prêtent aux accédants à la propriété). Ce dispositif est complété par la défiscalisation des intérêts d’emprunts, des plus values immobilières (à hauteur d’une exonération unique de 100 000$ en 1978, montant porté à 125 000 en 1981, avant de devenir en 1997 une exonération accessible tous les 2 ans à hauteur de 250 000 $ pour un célibataire ou 500 000$ pour un couple marié), l’organisation de la prolifération de l’offre de crédit en multipliant les acteurs autorisés à réaliser du crédit immobilier, des mesures anti discriminatoires réduisant de fait les possibilités de refus d’octroi de crédit.
L’imaginaire collectif américain ne cesse de se renforcer dans le sens de la propriété : chacun doit faire l’effort, à défaut de construire son ranch, d’être propriétaire de son logement. Les locataires sont vus comme ceux qui ne se sont pas donné les moyens, qui n’ont pas pris la peine, de participer au rêve américain. Même les politiques sociales sont in fine basées sur l’aide à l’accession à la propriété. Le pouvoir de l’imaginaire collectif laisse en effet penser que devenir propriétaire permettrait une stabilisation, que les enfants de propriétaires réussiraient mieux que les autres à l’école, que les propriétaires s’occuperaient mieux de leurs affaires, … Car au delà de fournir un toit, la propriété est, ou tout du moins était, également aux Etats Unis un moyen de s’enrichir. Et cela, grâce à un système d’emprunt où la capacité d’endettement est indexée sur la valeur de la maison.
Selon un mécanisme spécifique aux USA, une hypothèque est systématiquement déposée sur le bien acquis. Ainsi, à l’époque où la règle voulait que l’acquéreur dispose d’un apport initial de 20% du montant du bien, l’hypothèque portait sur les 80% restant du montant du bien (souvent de la maison). Concrètement, pour une maison achetée 100 000$, 80 000$ étaient gagés. Si l’acquéreur se trouvait confronté à 3 défauts de paiement de suite, la banque pouvait alors revendre la maison, de façon à récupérer ses 80 000$.
Dans le même temps, la valeur du bien est susceptible d’évoluer, selon la tendance du marché. Celui-ci ayant été en hausse quasi permanente et régulière depuis la guerre (connaissant tout au plus des périodes de stagnation), la croyance se développa que le marché serait éternellement haussier, et seul ce cas était réellement pris en considération. Revenons donc à la maison achetée 100 000$. Si les prix augmentent et que celle-ci est dorénavant estimée à 150 000$ sur le marché, voici l’acquéreur doté d’une capacité d’endettement additionnelle de 50 000$. Ils peuvent dores et déjà servir à financer la rénovation de la façade, le changement du système d’arrosage, à acheter un nouvelle voiture, le tout à crédit. Ou enfin, et surtout, si le bien initial trouve preneur, la culbute engendrée permet de se projeter vers une nouvelle maison plus grande, plus belle… plus chère, faisant bien de ce mécanisme une sorte de moteur auto entretenu du rêve américain. Enfin, tout du moins, tant que le système trouve de nouveaux entrants qui se trouvent preneurs des biens du « bas de l’échelle ». C’est dans cette optique, suite à une stagnation relativement longue du marché immobilier (de 1991 à 1997), que la puissance publique américaine décide de relancer le moteur et de favoriser l’accession à la propriété des familles les plus pauvres. Cela se réalise dés 1995 par l’autorisation de crédits à risques, dit subprimes – cf. ci-dessous – puis par l’assouplissement de la condition sur les 20% obligatoires d’apport initial et par la réorientation des politiques de Fannie Mae, qui consacrera à compter de 2000 50% de son activité à ce secteur. Couplé à la défiscalisation croissante des plus-values immobilières à partir de 1997, le haut et le bas du système sont stimulés, et le moteur repart à plein régime. Il sera aidé en cela par la crise des NTIC, qui propulsera l’immobilier comme valeur refuge face à la bourse, jugée trop volatile.
Ceux d’entre nous qui ont accédé à la propriété, ou qui sont déjà allé rencontrer leur banquier avec l’espoir de le faire, ont une idée assez précise de la façon dont se négocie un crédit immobilier dans notre pays. Examen des revenus, des encours de crédits, de l’apport initial, évaluation du reste à vivre, etc… le tout savamment mixé, confronté à une grille tarifaire adaptable à la marge en fonction de l’historique de la relation commerciale ou des perspectives de génération de produit net bancaire résultant de la domiciliation du salaire et des produits associés au compte courant dans le cas où le crédit serait accompagné d’un changement de banque. Aux Etats Unis, il en va passablement différemment. Les ménages sont en effet notés par l’agence FICO (toutes proportions gardées, celle-ci pourrait être comparée aux agences de notation pour les entreprises ou les pays). Un score, variant entre 300 et 850 est attribué en prenant en compte plusieurs facteurs : l’historique du remboursement des crédits du ménage (le paiement en temps et en heure des traites augmente le score), le taux d’utilisation des crédits (plus l’encours est important par rapport à la limite autorisée, plus le score sera affecté à la baisse), la durée de l’historique de crédit (plus il y a de profondeur d’historique, meilleur le score), les types de crédit composant l’historique (plus ceux-ci sont diversifiés, meilleur le score) et la fréquence des demandes récentes concernant votre historique (plus vous avez eu à en solliciter récemment, plus vous avez contracté de nouveaux crédits récemment, plus cela affecte négativement le score). On peut noter à ce stade à quel point ce mode de calcul reflète une certaine philosophie de l’économie de ce pays (qui vient renforcer la vision développée précédemment quant au rapport à la propriété) : le crédit est vu non seulement comme la norme, mais bien comme un élément de conduite du bon citoyen, le vecteur naturel de la croissance. A ce titre, avoir eu de nombreux crédits, dans des secteurs diverses et depuis longtemps est vu comme un facteur positif. Disposer de nombreuses lignes de crédit revolving (dans des proportions en tout cas très supérieures aux encours) de même.
Par le biais de cette notation, l’institution financière définit si le client doit être considéré comme présentant un risque faible de non remboursement (dit client « prime », correspondant à un score supérieur à 640) ou si au contraire, le client présente des risque de défaillance de remboursement (alors appelé « subprime », en dessous du prime, pour un score inférieur à la limite des 640).
Comme nous l’avons vu précédemment, dés 1995, la solution retenue face à un client considéré comme subprime ne fut plus de ne pas prêter, mais au contraire de prêter à des taux beaucoup plus élevés. La différence de revenu généré pour l’établissement prêteur en cas de bon remboursement étant alors la prime de risque, qui vient largement compenser les défaillances réellement constatées (d’autant plus que celles-ci sont déjà compensées par la revente des maisons concernées). On retombe là sur l’adage classique de la banque qui ne prête qu’aux riches : ceux qui auraient potentiellement le plus besoin de financement, puisque disposant du moins d’argent, sont ceux à qui l’opération reviendra le plus cher… Et l’on comprend que ce mécanisme fragilise ceux qui sont dés l’origine déjà fragilisé, et que cela crée donc les conditions de la survenance du risque crédit par les défauts de remboursement. Cette orientation politique se comprend d’autant mieux que l’on s’attache à la courbe de répartition des richesses aux USA et qu’on la compare à celle de la France par exemple : la répartition des richesses est beaucoup plus inégalitaire outre atlantique (1% détiennent 33% des richesses contre 27% en France tandis que 50% détiennent moins de 3% aux USA contre 9% en France). La seule manière de faire un pays de propriétaires (cf. statistiques énoncées précédemment) est donc de faciliter le recours à l’emprunt.
L’une des caractéristiques principales du score FICO est d’être recalculé en temps réel, impactant directement les sommes à rembourser au fil du temps. Revenons sur le cas du ménage ayant acquis son bien 100 000$, dont la valeur estimée a été portée à 150 000$ suite aux évolutions du marché. Imaginons que ce ménage ait fait le choix de financer avec sa ligne de crédit additionnelle de 50 000$ son nouveau système d’arrosage, sa nouvelle voiture, et de payer régulièrement ses courses alimentaires au supermarché, tout en continuant à payer les traites de son bien. Si pour une raison quelconque venant réduire la capacité de remboursement du ménage (nouvelle naissance, perte d’emploi, difficulté passagère liée à des frais médicaux, …) et qu’un arbitrage vienne à être nécessaire entre les remboursements de crédits, il se trouverait en fait que tous les arbitrages auraient les mêmes conséquences… catastrophiques pur le ménage. En effet, tout défaut de remboursement produit une réévaluation immédiate de la quote FICO. Dés lors, tout le reste des crédits se trouve immédiatement impacté : la prime de risque augmente et tous les autres emprunts avec (non seulement leur montant global, mais également le montant à rembourser immédiatement). C’est alors l’effet boule de neige : les sommes à rembourser augmentent alors que la capacité à rembourser reste fixe. Mécaniquement, ce sont alors les défauts de paiement qui se multiplient, provoquant la mise en action du mécanisme d’hypothèque sur la maison, jetant la famille à la rue.
Un autre cas peut toutefois également engendrer ce phénomène : une diminution des prix de l’immobilier. Supposons notre ménage sans difficultés de paiement sur ses différents emprunts contractés suite à l’estimation à 150 000$ de sa maison. Si tout à coup, l’estimation de la maison retombe à 120 000$, les établissements de crédit voient subitement 30 000$ qui ne sont plus garantis… et vont donc en demander le remboursement immédiat… ce dont le ménage est évidemment incapable vu que les salaires ont, au moins depuis 2004 progressé moins vite que l’inflation aux USA.
Dans ce scénario, la répartition sociologique induit que, en proportion, les détenteurs de crédit subprime seront les premiers touchés par les défauts de paiement et l’application des hypothèques, et seront touchés simultanément, expulsés afin que la banque puisse récupérer sa garantie. Les biens accessibles par les crédits subprimes étant souvent localisés dans les mêmes quartiers, un type de bien donné arrive soudainement en grande quantité sur le marché. L’écroulement des taux est alors accéléré, et entraîne à sa suite les biens des tranches légèrement supérieures, puis de proche en proche l’ensemble du marché immobilier. Le cercle vertueux devient alors cercle vicieux.
C’est ce scénario catastrophe qui a pris naissance à partir de l’automne 2005 quand les prix médians de l’immobilier baissèrent pour la première fois significativement (baisse de 3,3% entre le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006). La tendance se confirma sur tout 2006, et la multiplication des faillites de ménage eurent un effet massif, concrétisant le début de la crise dite des subprimes, en février 2007. Avec l’effondrement du cours de l’immobilier, les établissements de crédit ne parviennent plus à récupérer leur garantie par la revente des biens immobilier (dont la surabondance paralyse le marché), et enregistrent donc des pertes conséquentes, conduisant en février 2007 à la faillite de plus de 25 établissements de crédit commercialisant ce type de crédits.
L’histoire aurait presque pu s’arrêter là et se cantonner aux ménages et banques américaines. Mais plusieurs facteurs ont fait que la crise ne put être contenue aux seuls Etats Unis. Le premier facteur est responsable de la crise financière : c’est le mécanisme de titrisation. Ce terme quasi inconnu du grand public avant 2007 correspond à la création de produit financiers où les crédits sont agglomérés par paquets de 100, 200 voir plus pour devenir des titres, qui sont alors échangés sur les marchés. Les remboursements des traites constituent l’équivalent des dividendes. Ces produits financiers sont vendus comme étant extrêmement sûrs, puisque le taux du crédit est dores et déjà sensé couvrir du risque de non paiement, rendant en théorie impossible l’arrêt du versement des dividendes. Mais par ce mécanisme, le risque a été répandu dans tous les pays. Les fameux actifs pourris exposent aux risques subprimes (perte de valeur des titres dés que les défauts de remboursements se produisent) toutes les banques et entreprises ayant acheté des parts de ces produits financiers. La crise financière ainsi générée sort elle même du secteur financier pour gagner le secteur économique dés lors que des capitaux sont détruits. Ce sont autant qui ne viendront pas financer l’économie réelle, mettant en difficulté le secteur productif.
Le second facteur est le rôle de locomotive de la consommation Américaine dans l’économie mondiale, et il a renforcé l’effet de la crise économique induite par la crise financière. Avec la multiplication des défauts de paiement, les familles jetées à la rue réduisent, voir annulent, leur consommation. Les familles qui ne sont pas jetées à la rue voient tout de même le montant de leurs traites augmenter, induisant une perte de pouvoir d’achat, et par la même une réduction de leur consommation. La majeure partie des pays du Monde travaillant, non pas pour satisfaire ses besoins vitaux, mais ceux des Etats Unis, les conséquences économiques se firent sentir sur l’ensemble des pays produisant pour, et exportant vers, les Etats Unis.
En conclusion de ce chapitre sur les subprimes, cette crise peut être vue comme la conséquence de choix politiques, et comme étant la crise du système qui favorise l’accession à la propriété, en en faisant la réponse unique à la question du logement et de l’insertion sociale, le tout sans remettre en cause la répartition des richesses.
Les éléments entre aperçus précédemment ont un point commun : la volonté de certains acteurs d’accroître leur exposition au risque dans le but de maintenir un système qui leur permet de maximiser leur profit, faisant ainsi fi des impacts potentiels de leurs décisions et prises de risques, alors que celles-ci se sont avérées parfaitement structurantes pour des centaines de milliers de ménages. A l’aurée de ces éléments, il est intéressant de revisiter les thèses de Minsky, élaborées au même moment que l’avènement de la finance dérégulée, et donc avant que celle-ci ne produise ses effets, parmi lesquels les crises sus-mentionnées.
Selon Minsky, le secteur monétaire et financier, cherchant à maximiser ses profits, n’est pas spontanément en équilibre avec le reste des autres marchés de biens et services. En constante évolution, il est la source même des cycles économiques. Il distingue trois comportements types dans les processus de financement des agents : 1. Le financement couvert, dans lequel le rendement attendu de l’investissement couvre le paiement des intérêts et du principal dans un horizon de temps limité. 2. Le financement spéculatif, où le rendement attendu couvre le paiement des intérêts, mais la dette est constamment reconduite. 3. Le financement à la Ponzi (l’escroc éponyme a fourni dans les années 1920 l’exemple de l’escroquerie à la cavalerie, en attirant les épargnants bostoniens par des rendements exceptionnels, illusoirement fondés sur un arbitrage entre les tarifs postaux internationaux, un des avatars modernes serait le système Madoff), où, le rendement attendu ne permettant plus de façon régulière le paiement des intérêts, la survie du projet repose sur sa capacité à vendre des actifs ou à s’endetter plus.
Le cœur de la théorie de Minsky est son hypothèse d’instabilité financière chronique : de par la nature de ses acteurs, le système financier passe nécessairement d’un état de stabilité, dominé par le mode de financement couvert, à un état d’instabilité, dominé par la spéculation, puis le financement à la Ponzi. Au sortir d’une phase de crise, le secteur financier est bridé par les réglementations et les institutions mises en place, et par la prudence des prêteurs et des emprunteurs encore impressionnés par les grandes faillites. Dans cette phase du cycle, le financement couvert domine. La prospérité se développant, la vigilance publique et privée se relâche, l’endettement s’accélère, finançant des projets de plus en plus spéculatifs. « De plus, si une économie avec une large proportion d’entités spéculatives se trouve dans un état inflationniste et si les autorités monétaires essaient de conjurer l’inflation par une restriction monétaire, alors les entités spéculatives deviennent des « entités Ponzi », et les projets qui étaient déjà dans un mode à la Ponzi voient leurs actifs s’évaporer rapidement. » Les plus initiés commencent à vendre leurs actifs et les marchés baissent. La baisse des marchés se nourrit d’elle-même, une défiance généralisée sur la valeur des actifs s’installe, entraînant une profonde absence de négociabilité des actifs monétaires et financiers, même à des prix bradés.
Pour Minsky, il faut donc rapidement mettre en place un prêteur en dernier ressort qui interrompe la spirale de déflation des actifs. Il en identifie bien les difficultés : l’aspect paradoxal qu’il y a à secourir des entités spéculatives en prenant le risque de prolonger les causes même de la crise, sans parler de l’apparente injustice morale et sociale qu’il y a à sauver les spéculateurs avec l’argent de tous. Mais aucun de ces effets indésirables ne peut dispenser d’administrer le remède.
L’économie mondiale, dans sa configuration actuelle, présente également un obstacle de taille à la mise en place effective de ce prêteur en dernier recours. Les Etats Unis d’Amerique, dont le statut de première économie mondiale devrait les qualifier naturellement pur être ce prêteur sotn en fait dans l’incapacité absolue, du fait de leur dette abyssale, d’être ce prêteur. Il n’en fallut pas plus aux financiers pour comprendre qu’après les entreprises, ils pouvaient quasiment impunément s’attaquer aux Etats. Et c’est ce qu’ils firent dés que les Etats en questions eurent renfloué à grands sceaux d’argent public les acteurs spéculatifs, voir de Ponzi, qui avaient causé la crise. Certes, ils ne s’en prirent pas directement aux USA (sûrement par crainte de l’instabilité, et potentiellement de la remise en cause des règles courantes du jeu…) qui résulterait de l’effondrement de la première puissance mondiale. Mais des Etats aux caractéristiques similaires furent attaqués au motif de leur trop importante dette publique : Portugal, Espagne, et évidemment, le premier d’entre eux, chronologiquement parlant : la Grèce. Autant de pays qui, pourtant, présentaient des taux d’endettement comparables aux USA…
Surmonter ces obstacles s’articulerait en deux grands points :
la résolution de l’apparente injustice qu’il y a à sauver les agents spéculatifs, peut être aisément résolue : dans les cas de tels sauvetages, ceux-ci doivent nécessairement être conditionnés à des changements de politiques. C’est le principe de privatisation des profits et de nationalisation des pertes qui est injuste car spoliateur.
en ce qui concerne le prêteur en dernier ressort, l’Etat et sa banque centrale ne peuvent se contenter du rôle strictement financier de prêt relais. Ils doivent mettre en place une forte réglementation bancaire et financière. C’est exactement sur ce point que s’est nouée la crise Greque et les suivantes : sur l’incapacité des Etats à imposer des conditions aux marchés en contrepartie de leur sauvetage. Aussi, les Etats et les Banques Centrales doivent négocier le rachat de dettes liquides contre un rôle économique actif du secteur public, visant délibérément le plein emploi, y compris comme employeur direct. Sans quoi la solvabilité de l’Etat elle-même sera ébranlée, simultanément par la perspective d’une création infinie de dettes privées à reprendre un jour par le secteur public et par les perspectives d’augmentation cyclique de l’insolvabilité des ménages, conduisant à une chute des recettes budgétaires. Par delà la garantie de l’égalité des citoyens en leur garantissant un égal accès sur l’ensemble du territoire, un large secteur public a aussi pour fonction d’absorber les vagues créées par l’instabilité de la sphère privée.
Les représentations habituelles nous présentent l’actuelle crise de la zone Euro comme une crise de la dette publique. Or celle-ci vient, comme nous l’avons vu d’abord de la crise de la finance privée. Les Etats ont ensuite du réagir face à la récession introduite par cette crise de la dette privée. S’est alors surajoute à cela la transformation de la dette privée en dette publique par le sauvetage des bad actors du marché, et ce, contrairement à ce que l’éthique et la logique commanderaient, sans aucune contrepartie.
Cette crise risque ainsi de marquer la victoire d’une orientation politique : celle des gouvernements néolibéraux qui ne cherchent pas à éviter la crise et ses répliques, mais à l’instrumentaliser pour faire passer leurs projets de rigueur : rabaissement de la chose publique, privatisation, remplacement des assurance publiques par des assurances privées, … achèvement de la privatisation de l’Etat.
Les Etats n’ont en effet pas vu leur niveau d’intervention baisser dans les 30 dernières années. Leur mode d’intervention a par contre été profondément modifié : les Etats se sont peu à peu déchargés de leurs missions traditionnelles au profit de transferts de compétences vers les collectivités territoriales, sans que le budget suive toujours. L’estocade a été portée contre le travail. D’uneaprt par la réduction systématique d’emplois dans le secteur public, d’autre part en ne faisant que peu profiter les salariés des gains de productivités, qu’ils sont pourtant seuls à avoir porté. Dans le même temps, les allègements fiscaux se sont multipliés du côté du capital. Ainsi, bien que les interventions directes par le biais du secteur public soient de moins en moins importantes, jamais les Etats n’ont été aussi investis dans l’économie. A travers cette redistribution des moyens, c’est en fait l’obet même de cette intervention qui a changé : les néolibéraux ne voient pas un Etat protecteur du peuple en général, mais protecteur du seul capital.
Jusqu’à récemment, les néolibéraux n’avaient pas osé s’attaquer trop frontalement à l’Etat providence dans les pays tels la France, où, structurellement et historiquement, les services publics pèsent beaucoup dans le PIB. Une nouvelle tendance s’est cependant dessinée depuis les années 2000 : selon les théories de Milton Fridmann (« à situation de crise, traitement de choc »), les libéraux ont mis à profit les crises successives pour engager la purge qu’ils n’avaient pas eu le courage politique d’imposer brutalement. Une stratégie en deux temps a été mise en place à cette fin :
pendant des années, par les politiques d’allègements fiscaux, de défiscalisation de plus value, d’intérêts divers, ils ont troué les caisses de l’Etat et des caisses de protection. Rien qu’en France, sur les 10 dernières années, ce sont environ 100 milliards de rentrées fiscales qui ont été… perdues… Ainsi peut être instaurée al petite musique du déficit chronique, et l’idée du nécessaire changement peut être distillée à grand renfort de communication tout azimut sur la mauvaise gestion publique
la crise fournit alors le prétexte pour la cure de rigueur.
Sous l’impulsion de l’Allemagne, tous les Etats Européens sont en train de se lancer dans des politiques de rigueur. Cette situation rappelle celle du début des années 30 : il faut absolument réduire la dette publique, en jugulant les dépenses. Après coup, les économistes s’étaient pourtant rendu compte que le déficit public venait de a crise et non l’inverse, et que la diminution des dépenses publiques ne peut avoir pour seule conséquence que de creuser encore un peu la récession et de faire courir le risque de la régression durable… Mais les libéraux ont enfourché leur cheval de bataille, et voici l’austérité de retour dans l’idéologie dominante.
La question qui se pose alors à nous est la suivante : quelle politique alternative pourrions-nous proposer en tant que F:.M:. et sur quelles modalités devrions nous nous appuyer pour asseoir ces mesures?
L’un de nos FF:. Se plaît à le rappeler régulièrement : la F:.M:. est l’un des derniers espaces d’exercice, de défense et de promotion de la démocratie. Ce constat nous pousse à poser un grand principe fondateur de cette politique alternative : la souveraineté populaire! Y compris en matière économique, les citoyens auraient à exprimer leurs choix par des votes. Il ne saurait en aller différemment des autres sujets lorsque l’on aborde la finance ou l’économie.
Il s’agit sans doute là de la plus importante rupture avec le système actuel. Les dérégulations successives, les créations de marchés uniques, de zones de libre échange, … ont créé un système non démocratique, car la finance dérégulée est l’instrument de mise en oeuvre des politiques, généralement anti-sociales, décidées au sein d’instances non élues, mais ayant purtant des impacts beaucoup plus larges que sur la seule entreprise décisionnaire (chantage sur les retombées touristiques de l’implantation de Ryan Air, impacts sur les sous traitants d’entreprises industrielles, …). Dés 1987, et le premier opus du film Wall Street, Oliver Stone met d’ailleurs dans la bouche du magnat de la finance Gordon Gekko, interprété par Michael Douglas, une tirade enflammée visant à briser les velléités de son poulain de prendre, un peu, en compte des considérations sociales (en fait uniquement ne pas assurer la liquidation immédiate de la société…) au sein d’une entreprise dont il s’est porté acquéreur. Au cours de celle-ci, il expose la mainmise de la finance sur les affaires publiques et l’apogée de son discours est déjà « allons, tu ne vas quand même pas me dire que tu crois à la démocratie? ». Et bien nous si, nous y croyons, et nous souhaitons en refaire le pilier premier de toute société.
L’alternative qu’il nous faut construire mettrait donc la finance privée au service de l’intérêt général. Afin de garantir un financement adapté aux besoins de l’économie nationale, celle-ci devrait être gérée par des institutions publiques. A partir de ce point, 3 grands types d’orientation pourraient être débattus afin de déterminer les modalités d’application du principe fondateur :
que doit on faire en matière d’opérateurs financiers (concilier un secteur public et un secteur privé / n’avoir qu’un secteur public?, définition des opérateurs autorisés à intervenir sur les marchés : décloisonnement total des banques de détail et des banques de financement, …)
quels types d’instruments financiers (remise en cause de la titrisation, de beaucoup de produits dérivés, limitation des effets de leviers, crédit à la consommation, …). Face à la créativité infinie générée par la cupidité, pourrait-on, sur ce secteur, envisager un renversement du principe qui prévaut habituellement en droit pur instaurer que tout ce qui n’est pas explicitement autorisé pourrait être présumé interdit?
Modalités de réglementation des marchés (instauration de l’obligation d’agrément public pour intervenir sur les marchés financiers, limiter les transactions aux marchés organisés – pas de marchés de gré à gré – re-réglementation stricte des transactions financières, interdiction de certains types de transactions – vers les paradis fiscaux par exemple – taxation des transactions internationales, …)
Voici les premières pistes de réflexion que je souhaitais soumettre à votre sagacité. Je ne doute pas que certaines vous auront interpellé et je vous propose donc que nous passions de ce pas au débat afin de les enrichir.



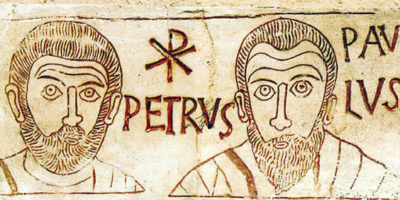
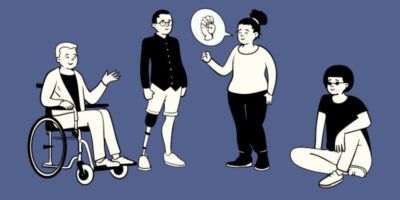

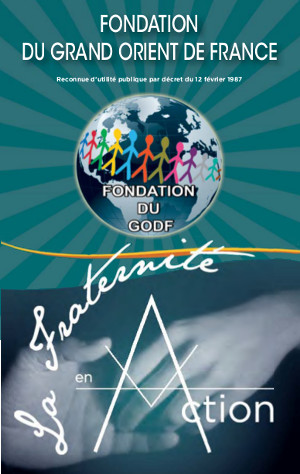

Leave a Reply