 Il fut un temps où il suffisait de parler de développement et on avait l’impression de comprendre, même si déjà il n’était pas certain que nous avions tous la même compréhension du terme. Or depuis 1987 et la première définition du terme de développement durable dans le rapport Brundtland, ce terme à double entrée est utilisé comme un notion en soi. Les organisations internationales le posent comme jauge de développement.
Il fut un temps où il suffisait de parler de développement et on avait l’impression de comprendre, même si déjà il n’était pas certain que nous avions tous la même compréhension du terme. Or depuis 1987 et la première définition du terme de développement durable dans le rapport Brundtland, ce terme à double entrée est utilisé comme un notion en soi. Les organisations internationales le posent comme jauge de développement.
Développement durable
Le terme anglais de « sustainable », traduit en français par durable, ne traduit pas exactement l’idée qui veut plus dire soutenabilité, du verbe « to sustain » (soutenir ou supporter). Cette traduction en durable, met l’accent sur l’axe temporel et par, extension, intergénérationnel, d’où l’importance donnée à l’aspect environnemental du développement.
La définition de Brundtland qui est de dire que « le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures ». C’est logique, et même plus tautologique car de quel développement parlerait-on si elle impliquait l’incapacité pour les générations futures de le maintenir ? Ou inversement, existerait-il des développements qui ne soient pas durables ; et si oui, seraient-ils des réels développements ?
Au-delà de cette définition de développement durable relativement vague, une deuxième est censée préciser cette notion et la décliner sur trois axes (l’économie, le social et l’environnement). Il va de soi que cette déclinaison sur les trois dimensions pose la question des conflits entre elles. La dimension politique qui est devenue également un « must » de tous les textes onusiens, considérée sous l’angle de la gouvernance, n’a été prise en compte que depuis quelques années. C’est une reconnaissance tardive de la dimension politique qui, malgré tout, détermine toutes les décisions en matière de l’économie, du social et de gestion de l’environnement.
Historique de l’émergence de la notion
Il est intéressant ici de faire un rappel du contexte historique dans lequel a émergé le concept de développement durable. A partir du début des années 70, les catastrophes écologiques causées par les activités économiques suscitent des questionnements et débats autour des impacts négatifs de l’industrialisation. Plus tard, les crises pétrolières suscitent pour leur part une autre dimension de la problématique qui est celle de l’épuisement des ressources naturelles nécessaires pour continuer la croissance.
Les évènements-clé furent :
le premier sommet de la Terre – Conférence de Stockholm – en 1972 et qui fait suite au rapport Meadows. Le rapport Meadows, intitulé Limits to Growth ou en français Halte à la Croissance ?, avait été commandité par le Club de Rome, fondé en 1968 et regroupant des personnalités occupant des postes important. Ce rapport prévoyait que la planète et l’humanité étaient menacées par le rythme de la croissance économique et démographique. Il contient l’idée d’une « croissance zéro » pour éviter la catastrophe grâce à « un état d’équilibre, qui signifie un niveau constant de population et de capital ». Les intérêts divergents des pays industrialisés et ceux en voie de développement rendirent impossible un consensus. Les vingt-six principes et cent neuf recommandations adoptés restèrent lettre morte.
Le deuxième sommet de la Terre – Conférence de Rio de Janeiro 1992 – à la suite du rapport Brundtland. C’est le rapport Brundtland (1987) de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, qui propose une définition de la notion de développement durable, qui sera médiatisé et vulgarisé à partir de la Conférence de Rio. Cette notion écarte graduellement de l’ONU celle d’écodéveloppement, proposée par le secrétaire général de la Conférence de Stockholm. Le terme de « sustainable development » était jugé plus politiquement correcte dans un contexte de retour en force du libéralisme et du primat de la croissance économique et technologique.
La Conférence de Stockholm avait mis l’accent sur la relation développement et environnement et la démographie alors que vingt ans après, la conférence de Rio met l’accent sur une définition certes floue, mais qui a l’avantage d’éclipser la question démographique au profit d’autres problématiques telles la lutte contre la pauvreté et les inégalités, les droits de la femme. « Rio +5 », bilan en 1997 par l’ONU de la conférence de Rio constate que les résultats sont mitigés et que les rapports de force entre pays développés et ceux en voie de développement n’ont pas changé et que les disparités économiques se sont amplifiées.
Il s’agit pour nous de réfléchir non seulement sur le concept de « durabilité » du développement, mais également sur le concept du développement lui-même. Comment se différencie-t-il de croissance, accumulation de richesse, ou d’autres notions souvent substitutives qu’on croît à tort être le développement ? On notera d’ailleurs qu’avant les années 70, les termes de croissance et de développement était pratiquement interchangeables et souvent utilisés comme synonymes. Le niveau de développement d’un pays était mesuré selon des indices de la croissance économique et les pays du monde classés – à l’époque – en développés, en voie de développement et sous-développés selon des critères économiques. L’idée sous-jacente à cette vision était que les pays industrialisés étaient le modèle même du développement et que tous les pays du monde étaient à un niveau ou à un autre dans l’échelle qui mène à ce modèle unique de développement axé sur l’industrialisation et l’urbanisation. Pour les opposants à cette vision, les pays industrialisés l’étaient précisément parce qu’il y avait un rapport de domination-dépendance issu du colonialisme et de l’impérialisme et que le modèle de développement des pays industrialisés a pu marcher parce qu’il y avait les pays dits sous-développés avec des économies qui tournaient sur l’exportation des matières premières (coton, café, bois, pétrole, etc.) vers les pays industrialisés. Le contexte de cette période de guerre froide et de lutte idéologique explique également la recherche d’autres modèle de développement qui ne soient pas basé sur l’industrialisation et l’urbanisation, notamment l’Inde avec la Révolution verte dont le but est d’éviter l’exode rural et intensifier l’agriculture. Des modèles souvent centrés sur la réactivation des structures sociales pré-coloniales (villageoises en Inde, Ujamaa en Tanzanie, Fokolona à Madagascar).
Le postulat d’un modèle de développement unique valable universellement pour tous les pays, outre ses connotations de déterminisme quasi-biologique – le bébé devenant adulte ou la chenille se transformant en papillon – pose le problème de la persistance du décalage entre pays industrialisés et pays en sous-développement (pourquoi certains bébés restent-ils toujours bébés ?). Il nous faut alors accepter l’idée qu’il n’y a pas qu’un seul modèle de développement et qu’il n’y a aucun déterminisme dans l’évolution des sociétés, mais que tout est question de choix politique.
L’avantage de cette nouvelle vision du développement qualifié de durable est qu’elle intègre les dimensions aussi bien écologique qu’économique et sociale. Ainsi, des nouveaux indices sociaux tels l’IDH (Indice de Développement Humain) et économiques (les écarts de revenus dans la population) ont été élaborés dans les institutions internationales comme l’ONU, l’OCDE, etc. pour évaluer si les processus de développement amène l’équité sociale. Mais c’est surtout sur l’environnement que les avancées ont été les plus nombreuses dans ces institutions. Le constat étant que le problème de l’environnement ne respecte pas les frontières nationales (pollution, couche d’ozone, déforestation, diversité biologique, ressources non renouvelables) et que l’approche devrait être globale. Ce sont surtout ces mesures écologiques qui suscitent le plus de réserve de la part des pays du Sud qui estiment qu’il est absurde d’attendre de leur part des sacrifices au nom de la durabilité si des mesures n’ont pas été prises au préalable au Nord. Ainsi le Gabon qui base son développement sur la seule exploitation d’une ressource, le pétrole – ressource épuisable – ne serait pas écologiquement durable. Ou encore l’imposition de parc naturels et zones protégées (forestières par exemple) ont eu un fort impact négatif sur le mode de vie des populations qui dépendaient de ces zones. Au nom de quelle légitimité les pays riches, maintenant développés, imposeraient-ils aux pays en développement une vision limitative de leur développement ?
Alors que le rapport Meadows de 1972 préconisait une « croissance zéro », certains membres, les décroissants ou « objecteurs de croissance » font une remise en cause totale du concept de croissance économique et estiment que la décroissance est inéluctable du fait de la raréfaction des ressources naturelles, particulièrement énergétiques, et que plutôt que d’attendre les pénuries et tensions et crises géopolitiques qu’elle entraînerait le mieux serait de l’amorcer maintenant.
La mondialisation équitable
Quant à la mondialisation équitable, le problème de traduction se pose également. En anglais globalisation, il est traduit en français par le terme de mondialisation. Cette différence n’est pas que sémantique, même si du point de vue des racines étymologiques, on pourrait dire que les deux « globe » et « monde » soient équivalents. Elle est aussi méthodologique « globe » s’inscrivant surtout sur un axe géographique alors que monde renvoie plus une dimension « globale » ou « totale » de la vie humaine incluant politique, culture, philosophie, etc. En français, le terme de globalisation renvoie beaucoup plus à une dimension économique des activités humaines des différentes régions du globe alors que la mondialisation implique également les dimensions culturels, alimentaires, vestimentaires, et cela pas seulement sous l’angle économique. Par ailleurs, on ne parle pas de mondialisation économique, car l’économique est déjà inclus dans le concept de mondialisation. On la désignerait plutôt par l’expression de « globalisation économique ou financière »
Les sources Internet tel que Wikipedia donne comme définition « le développement de liens d’interdépendance entre hommes et femmes, activités humaines et systèmes politiques à l’échelle du monde ». Une définition aussi vague ne satisfait pas car elle entraîne la réflexion que la mondialisation n’est pas nouvelle. Il y a eu le commerce des esclaves, la colonisation, des échanges certes inégaux mais mondiales – du moins dans ce qui était technologiquement et géographiquement le monde. L’esclavage et la colonisation et ultérieurement l’utilisation des coolies sont une forme mondiale d’échange des biens et main-d’œuvre bien que ce soit une exploitation et l’asservissement des peuples du monde. La mondialisation ne serait donc pas un phénomène nouveau, mais vieux comme le monde.
On pourrait se poser la question de la différence entre la mondialisation telle qu’elle existait avant notre époque et celle qui est en cours actuellement. Certains diront que c’est l’intensification et l’extension des échanges de biens, services et main-d’œuvre à tous les endroits du globe, mais c’était déjà le cas dans l’ancienne mondialisation. Ce n’est que dans les années 70 que le volume des exportations est arrivé à dépasser le niveau qu’il avait déjà atteint au début du siècle (1913) et déjà à cette période là Lenine dans son livre sur « L’impérialisme – stade suprême du capitalisme », avait décrit la constitution du capital financier, comme séparé du capital industriel; et donc la mondialisation des flux des capitaux financiers et leurs effets sur les classes ouvrières des pays industrialisés. D’autres auteurs ont également dans les années 60 et 70 décrit le monde comme un système économique global dans lequel il y a un centre et une périphérie (Samir Amin et d’autres), mais ils analysaient le système plus du point de vue d’une domination de certains pays industrialisés sur le reste du monde. Et on est loin de l’image idyllique d’un monde village global que serait le visage qui émerge par la suite. S’il existe un domaine où il existe effectivement un village global, c’est celui de l’univers financier, le marché intégré de la finance, favorisé par les avancées technologiques qui permettent de désinvestir du Brésil pour investir au Bangladesh dans la même seconde.
Pour comprendre la rupture entre la mondialisation actuelle et celle qui la précédait, il nous faut probablement revoir l’histoire économique récente et plus particulièrement le rôle des institutions internationales telles que l’OMC. On peut vraiment dater cette nouvelle phase de la mondialisation du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ou Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce) de 1947 conclu entre les 23 pays avec pour but la liberté des échanges par l’abaissement des tarifs douaniers et la réduction des restrictions aux échanges entre les pays contractants.
Le GATT passe de 23 pays en 1947à 120 pays en 1994 après 8 rounds (cycles) de négociation qui s’étalent sur cette période. Le dernier round tenu se termine par la création de l’OMC en 1994 car jusqu’ici le GATT n’était qu’un cadre et non une organisation internationale et n’avait donc aucune personnalité juridique internationale. L’OMC, que beaucoup associent à une organisation onusienne n’est pas du tout une émanation de l’ONU même si elle est reconnue par celle-ci. Pour sa part l’ONU avait déjà la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement) créée en 1964 pour promouvoir des échanges commerciaux équilibrés, notamment par l’accès des pays du Sud aux marchés du Nord et par l’amélioration des termes de change. La CNUCED, organisme onusien chargé de réguler le commerce et le développement au niveau mondial, est tombé depuis en désuétude alors que l’OMC, au départ club privé des pays riches et dont l’objectif était le libre-échange sans restriction dans une optique libérale, s’est généralisé au point d’intégrer des pays à première vue pas très compatible comme la Chine, membre depuis 2001.
A partir des années 1980, les échanges commerciaux au niveau mondial explose littéralement et le terme de mondialisation commence à prendre de la visibilité. Si l’idée d’une mondialisation comme d’un processus qui intègre tous les territoires du globe dans un seul système où les biens, services, main-d’œuvre et capitaux sont censés circuler sans restriction s’impose, on se rend toutefois compte que c’est surtout au niveau des flux financiers que les choses sont les plus avancées avec un marché intégré des capitaux au niveau de la planète et des volumes d’IDE (Investissement Direct Etranger) jamais vus. Les grands gagnants de cette globalisation financière sont surtout les firmes multinationales, les investisseurs institutionnels, les établissements de crédit etc. La logique financière prend le pas sur la logique industrielle et les premières délocalisations d’usines et ensuite des services apparaissent.
Beaucoup y voyaient là une chance pour les pays pauvres de rattraper leur « retard de développement » et on citait les pays nouvellement industrialisé, notamment les « petits tigres asiatiques » comme exemple des bienfaits de la mondialisation. Et ce jusqu’à la crise asiatique qui est venu démontrer les risques d’une dépendance trop forte sur les marchés financiers aussi rapides à investir qu’à désinvestir. Dans les pays riches, on commence à déchanter car si on est content d’avoir les jouets made in China à pas cher, on l’est moins quand on a perdu son emploi du fait de la délocalisation de son usine en Thaïlande. Quant aux pays pauvres, ils sont généralement hors du système mondialisé car basées sur l’agriculture, leurs économies se heurtent au système protectionnistes des pays riches sauf pour certains produits agricoles spécifiques (bananes, mangues, etc.) ou ressources minières.
La mondialisation peut-elle être équitable ? Et l’équité serait par rapport à quel acteur (local, national, groupe social ou ethnique) ? Ou à quelle échelle (pays, régions, continents) ? Nous avons utilisé le terme de territoire quelques lignes plus haut car ce ne sont plus tellement les pays qui sont intégrés dans le système-monde, mais des parcelles d’un pays. La mondialisation accroît les inégalités aussi bien sociales que spatiales. L’Inde est un cas typique où les 4 grandes villes reliées entre elles par des autoroutes modernes qu’on appelle le « Golden Quadrilateral » possèdent les industries technologiques modernes et des réseaux de communication ultra-rapides et sont dites intégrés dans le système monde. Le reste du pays est très peu intégré. La côte orientale de la Chine également est dans ce cas ; il y poussent des nouveaux petits millionnaires, gagnants dans la mondialisation alors que le reste du pays en est exclus. Dans les pays riches on voit également cette polarisation entre des types de territoires avec émergence de pôles d’activités intégrés dans le système monde et des zones qui en sont exclus. Les géographes qui travaillent sur le phénomène de la mondialisation estiment qu’une nouvelle géographie est en train de se dessiner avec un centre composé de l’Europe de l’Ouest, des Etats-Unis et du Japon, et une périphérie composé des pays et territoires qui sont plus ou moins intégrés à ce système et des zones qui en sont exclus ainsi qu’une nouvelle division internationale du travail : le centre la décision et le capital tandis que les PNI produiraient.
Dans ces conditions, la mondialisation peut-elle être équitable si de par son fonctionnement elle produit de la richesse pour un petit nombre de gagnants et une accentuation de la pauvreté pour un grand nombre de perdants ? Ne serait-ce pas qu’une extension du système capitaliste au niveau mondiale ? Et dans le contexte du démantèlement des structures étatiques comment les économies nationales des différents pays pourront-elles échanger sur une base équitable ? Une tendance actuelle des pays les plus vulnérables à la mondialisation consiste à se regrouper pour être en mesure de négocier équitablement avec les pays riches. Ainsi, les petits Etats insulaires se sont regrouper pour négocier des conditions et exceptions au sein de l’OMC. Ou encore, dans beaucoup de régions du monde, des regroupements régionaux sont préconisés (SADC – South African Development Community – ou COI – Commission de l’Océan Indien ou ASEAN – Association of South East Asian Nations) car estime-t-on il y a lieu que l’intégration dans le système monde doit se faire par pallier (des level playing fields) et que l’intégration doit se faire avant tout au niveau régional avant l’intégration dans le système monde réellement.
Quelles implications cette question a-t-elle pour la franc-maçonnerie et pour les franc-maçons ? Ce sont deux phénomènes qui altèrent sinon conditionnent les conditions de vie de l’Homme sur deux dimensions : une dimension temporelle (le développement joue sur l’axe temps, la chaîne générationnelle) et une dimension spatiale (la mondialisation vise à éliminer l’espace qui sépare les groupes humains et leurs organisations sociales et culturelles). Aussi, au-delà de l’analyse scientifique, du constat froid de l’absence de l’Homme dans les divers mécanismes qui sont à l’œuvre et qui se font même souvent au détriment de l’Homme, cette question appelle un positionnement moral.
Si le concept de développement durable a pu dans un premier temps paraître positif en remettant la question de la survie de l’humanité au centre des préoccupations du développement, il semble qu’il n’est plus une réelle alternative. Et que, dans les temps actuels de crise économique, c’est précisément l’inverse, un développement insoutenable, qui est en train d’être mis en place par l’investissement massif des Etats dans l’industrie automobile alors que dans le même temps ces mêmes Etats se désengagent de tout ce qui est collectif, notamment les transports publics, plus économes en énergie.
Cet échec d’une remise en cause du modèle dominant de développement par le concept de développement durable montre également les limites de ce qu’il est possible de faire dans le cadre d’un système dit libéral où la financiarisation de l’économie, la croissance à tout prix et la recherche de profit sont moteur de la société et non les besoins des populations. Autrefois pensé en termes de progrès – répondre aux besoins physiques, intellectuels et spirituels des hommes – le développement s’est vidé de ses valeurs morales pour n’être plus que croissance économique et puissance financière et cela d’autant plus dans un contexte de plus en plus globalisé. Seul un recentrage global des projets de société sur les besoins réels des hommes peut rompre le cycle croissance – crise et éviter ainsi la catastrophe.



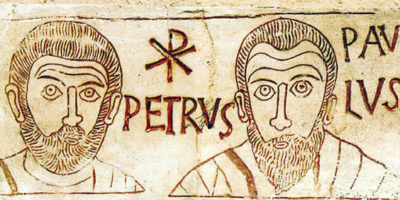
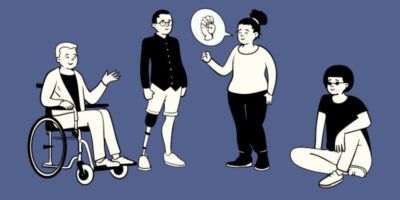

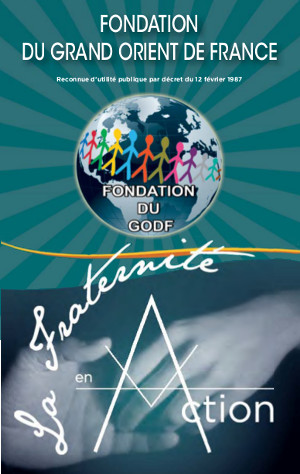

Leave a Reply